L’intuition du vivant
La plupart des scientifiques ayant cherché à comprendre l’intuition sont des psychologues. Normal, puisqu’il s’agit d’étudier une faculté de l’esprit humain. Mais ces recherches peuvent aussi intéresser les biologistes, qui peuvent se demander si l’intuition existerait ailleurs que chez l’Homme. De nombreuses anecdotes et quelques expériences scientifiques appuient cette hypothèse…
Les biologistes ont plusieurs raisons de vouloir s’intéresser à l’intuition, en particulier l’intuition non locale, cette source d’information immédiate qui n’a besoin ni de pensée raisonnée ni de renseignements sensoriels, et dont l’existence a été démontrée chez l’Homme (Science de l’intuition).
La biologie de l’intuition
La première raison concerne l’origine-même de cette intuition : a-t-elle besoin d’un support biologique, de processus physiologiques particuliers ou d’un certain type d’organes ? Des conditions physiologiques sont-elles nécessaires, ou associées, aux perceptions intuitives ?
Une autre raison est que l’intuition non locale pourrait bien être une faculté universelle, une caractéristique du vivant. Une telle hypothèse mérite d’être explorée. Elle permettrait d’interpréter d’un regard neuf de nombreuses observations en biologie, notamment des faits qui restent inexpliqués.
Et s’il s’avère que l’intuition existe chez d’autres êtres vivants, on peut se demander quel est son lien avec l’évolution. Cette faculté s’est-elle développée parce qu’elle procure aux espèces un avantage en termes d’adaptation ? Différentes formes de l’intuition reflètent-elles des paliers évolutifs ? L’intuition – aptitude à percevoir un objectif sans raisonnement ni indice – a-t-elle joué un rôle dans les processus de l’évolution eux-mêmes ?
Le cerveau est-il nécessaire ?
Le cerveau est le siège de notre pensée, de nos perceptions, de nos facultés de connaître, et de tout ce qui fait notre vie psychique. On pourrait donc douter que des êtres vivants qui n’ont pas un cerveau développé puissent avoir, comme les humains, de l’intuition. Des primates et des mammifères supérieurs, à la rigueur… mais certainement pas toutes les créatures vivantes. Toutefois penser ainsi relève d’un biais – le même qu’on rencontre souvent quand il est question de l’intelligence animale.
Il est vrai que chez l’Homme l’intuition mobilise souvent son cerveau. Cet aspect de la recherche sur l’intuition concerne les neurosciences ; de nombreux travaux ont déjà été publiés, montrant des relations entre notre activité cérébrale et nos perceptions intuitives (cf Localiser l’intuition dans le cerveau Depuis longtemps, des chercheurs ont émis l’hypothèse que certains aspects de l’intuition seraient le fait d’une région spécifique du cerveau – plus précisément du cortex, siège des fonctions cognitives... Cliquez pour aller plus loin.)
Mais en matière d’intuition, le cortex ne fait pas tout. L’activité cérébrale peut être corrélée aux processus intuitifs tout comme elle corrélée à tout ce que nous pensons, éprouvons, voulons et faisons. Cela ne veut pas dire que le cortex soit la cause de ces processus, ni qu’il leur soit indispensable.
De fait, la plupart du temps la connaissance intuitive se manifeste à travers des émotions, des ressentis, des tendances inconscientes, des réflexes, et pour cela un cerveau « reptilien », siège des émotions et des automatismes, suffit amplement. Mieux, on a montré en laboratoire que l’intuition humaine se manifeste, sans que nous le sachions, dans toutes les parties du corps, tous les organes des intestins à la peau en passant par le cœur ou les yeux (cf Activité physiologique et intuitionPour mettre en évidence le pressentiment, on peut mesurer diverses formes d’activité physiologique au niveau de différents organes... Cliquez pour aller plus loin.). Cette « intuition du corps » prouve que le cerveau n’est pas indispensable à certaines formes d’intuition. Rien n’interdirait alors que d’autres formes de vie aient de l’intuition.
Pourrions-nous le mesurer scientifiquement ? La réponse est oui.
Durant sa carrière, le biologiste français Rémy Chauvin s’est passionné pour de nombreux sujets, y compris les facultés mal comprises de la conscience. Dans les années 1960, il s’intéressa aux travaux des psychologues américains sur l’intuition humaine. Or certains de ces protocoles expérimentaux peuvent être adaptés aux animaux. C’est ce qu’il fit.
Dans une des expériences que réalisa Chauvin, des souris étaient placées individuellement dans une cage divisée en deux zones. Chaque zone était électrifiée au hasard, pendant quelques secondes ; parfois la souris s’y trouvait au mauvais moment, parfois elle n’y était pas, et échappait à l’expérience désagréable du choc électrique. La souris n’ayant aucun moyen de savoir à l’avance quand et où se produirait l’électrification partielle de la cage, sa probabilité de connaître un choc était d’une chance sur deux. Avec plus de six cents essais, Chauvin montra que les souris évitaient le choc électrique plus souvent qu’au hasard, de manière statistiquement significative (p <0.001) (Duval & Montredon 1968).
Ce type d’expérience a été refait, par Chauvin et d’autres équipes, avec des souris mais aussi des lapins et d’autres rongeurs (Levy et al. 1971, Levy & Terry 1973). Les résultats ont toujours été positifs et statistiquement significatifs.
L’intuition des animaux domestiques
L’expérience de Chauvin avait un précédent : quelques années plus tôt, on avait testé l’intuition de chats et de chiens. L’auteur de ces expériences était un chercheur d’origine lettone, Karlis Osis, émigré aux Etats-Unis après la Seconde guerre mondiale et travaillant dans le laboratoire de Joseph B. Rhine – pionnier des recherches modernes sur l’intuition humaine. Chats et chiens sont si proches de nous, leur niveau d’intelligence est si remarquable, qu’ils sont bien évidemment d’excellents candidats pour tester l’intuition animale.
On observe chez ces animaux les mêmes sortes d’intuition que chez les humains (les scientifiques parlent de « modalités » de l’intuition) : intuition temps réel (perception de choses cachées ou d’événements qui se déroulent ailleurs), intuition du futur (perception d’événements qui ne se sont pas encore produits), intuition entre individus – animaux de la même espèce, d’espèces différentes, ou entre animaux et humains.
Les propriétaires de chats savent que ces derniers ont une bonne intuition du futur. La plupart des chats détestent les rendez-vous chez le vétérinaire. Même si toutes les précautions ont été prises pour le leur cacher, la veille ou quelques heures avant le rendez-vous, ils disparaissent ! Le biologiste anglais Rupert Sheldrake, spécialiste de l’intuition animale, rapporte que sur 65 cliniques vétérinaires de Londres contactées, 64 avaient en effet régulièrement des annulations le jour J pour cause de chat introuvable ; la dernière clinique avait même laissé tomber le système de rendez-vous (Sheldrake & Smart 1998).

Comme les chats, les chiens semblent percevoir ou anticiper des faits qu’ils ne devraient pas connaître. Qu’il s’agisse d’expériences déplaisantes pour eux – on veut les amener chez le vétérinaire, les laver, les traiter contre les puces – ou agréables – on va les nourrir, les promener, leur maître ou leur maîtresse va bientôt rentrer à la maison – leur comportement indique qu’ils sentent ce qui va arriver. Ruper Sheldrake a compilé et étudié un grand nombre de ces cas où l’animal domestique indique clairement, par son comportement (et dans le cas des perroquets, par ce qu’il dit), qu’il sent que la personne avec qui il a établi un lien affectif va revenir, ou leur apporter à manger, même si cet horaire est hors de toute routine et impossible à prévoir.
Quels sont les animaux domestiques concernés ? Surtout les chats, les chiens, les chevaux, les oiseaux (en particulier les perroquets, perruches, poules, oies et canards), les singes. Selon Sheldrake, on ne dispose pas d’observations similaires pour des reptiles d’appartement, des poissons d’aquarium ou des hamsters. En soit c’est un résultat intéressant, qui pourrait nous apprendre quelque chose sur l’intuition animale. Mais il est possible que cette absence de données résulte d’un biais culturel : en effet, si la plupart des gens sont persuadés que telle sorte d’animal n’est pas dotée d’une grande intelligence, ils accorderont peu d’attention à certains détails étranges de leur comportement, ou voudront les attribuer au simple hasard.
Le lien affectif joue-t-il un rôle ?
Les animaux de compagnie, par définition, vivent au contact des humains. Ils semblent percevoir intuitivement des faits concernant ceux dont ils sont proches (leur état de santé, leur humeur du moment, leurs intentions). Un grand nombre de personnes épileptiques possédant un chien ont noté que leur chien pressentait l’imminence d’une crise, tentaient de les avertir ou de prévenir l’entourage (Edney 1993). De nombreuses personnes ont échappé de peu à des accidents pouvant s’avérer fatals par le comportement inhabituel et têtu de leur chien, de leur chat ou de leur cheval ; des cas ont été rapportés où des gens furent sauvés du suicide in extremis grâce à l’intervention de leur animal de compagnie, averti de ce qui se tramait par un sixième sens (Sheldrake 1999).
Il s’agit d’une forme d’intuition entre l’humain et l’animal : un partage, instantané, souvent inconscient, des états intérieurs, des émotions, des intentions, voire de pensées clairement formulées. Dans une intuition reliant deux individus, on peut se demander qui initie l’échange. De temps immémoriaux des chamanes et des personnes particulièrement douées pour comprendre les animaux – notamment de nombreux saints, comme François d’Assise – affirment pouvoir communiquer avec toutes sortes d’espèces. Mais la plupart du temps, c’est l’animal qui semble capable de « lire » dans les pensées de l’être humain.
Les perroquets, qui ont l’avantage de savoir parler, et qui semblent penser à haute voix, montrent qu’ils sentent à l’avance le retour à la maison de leur maître ou de leur maîtresse. Ils anticipent ce retour dix à trente minutes avant, bien que l’horaire du retour change fortement d’un jour à l’autre. Sheldrake a montré dans des expériences qu’un perroquet peut répéter les mots que dit son propriétaire, au même moment, dans une pièce éloignée et insonorisée (Sheldrake & Morgana 2003).
Certaines personnes côtoient aussi chaque jour des animaux dans un cadre professionnel : éleveurs, dresseurs, employés de zoos, de parcs aquatiques, de cirques, d’animaleries. Dans ces milieux, où des liens émotionnels peuvent aussi se créer entre les animaux et les humains, on rapporte les mêmes sortes d’anecdotes.
Il est parfois difficile de savoir si l’on constate une intuition du futur, une intuition temps réel, ou une intuition entre l’Homme et l’animal. Le chien qui pressent que son maître va rentrer perçoit peut-être l’événement qui le réjouit d’avance, ou, à distance, les intentions de son maître. Les rats qui quittent les égouts et les vers qui sortent de terre quelques jours avant une catastrophe naturelle perçoivent peut-être l’imminence de celle-ci, ou l’effet émotionnel que cette catastrophe aura pour un grand nombre d’êtres vivants – humains compris. La même sorte d’ambiguïté existe dans les expériences sur l’intuition purement humaine ; quand on teste une personne, il arrive qu’on ne sache pas si l’on a mesuré son intuition et rien d’autre, ou l’intuition entre cette personne et l’expérimentateur, ou un mélange des deux.
Dans le cas humain, l’étude de l’intuition entre personnes a découlé sur des conclusions qui semblent s’appliquer au cas de l’intuition entre l’humain et l’animal : l’existence d’un lien affectif favorise la communication intuitive (cf des cerveaux connectésCes dernières années, plusieurs études en neurosciences ont été publiées sur des expériences de « télépathie » : l’activité cérébrale d’un individu est enregistrée au moyen d’un casque EEG… Cliquez pour aller plus loin.). On peut spéculer sur le fait que les animaux qui manifestent moins cette forme d’intuition sont des animaux dont l’espèce est peu sociale, et pour lesquels la vie émotionnelle et les aptitudes à s’attacher sont réduites (Sheldrake 1999).
La boussole du grand voyageur
La capacité de certains animaux à retrouver leur domicile après avoir parcouru d’immenses distances en territoire inconnu, représente en soi un sujet d’étonnement scientifique (Rhine & Feathers 1962). En 2024, un chat appelé Rayne Beau, perdu dans le parc national de Yellowstone aux Etats-Unis, a reparu chez lui des mois plus tard, à 1280 kilomètres de là. De nombreux animaux sauvages sont capables de prouesses similaires, pour atteindre un lieu précis après un immense voyage. Les biologistes appellent cette faculté qu’ont les animaux de se diriger vers un but, où qu’il soit, et sans se référer à aucun repère, la « navigation biologique » (McFarland 1981). C’est un sujet de recherche ancien, pour lequel on a fait de nombreuses hypothèses, et où l’étude de l’intuition animale peut apporter de nouveaux éclairages.
Les chiens sont capables de « naviguer » sur des dizaines de kilomètres ; les loups font cela sur plus de cent kilomètres. La plupart des animaux, semble-t-il, sont capables de navigation biologique à des degrés divers. Cette faculté est vitale pour de nombreuses espèces d’animaux qui, dans le milieu naturel, doivent franchir, chaque année à certaines saisons, ou à chaque génération, des centaines ou des milliers de kilomètres par les océans ou par les airs afin de retrouver le cours d’eau, la plage ou la clairière de leur naissance où ils se reproduiront.
Les albatros, même déplacés sur un continent qu’ils ne connaissent pas, retrouvent en une dizaine de jours leur île au milieu de l’océan Pacifique après un voyage de trois mille kilomètres. Tortues de mer, papillons monarque, esturgeons, saumons ou anguilles, font des pèlerinages de cette sorte. La manière dont les insectes trouvent leur chemin est tout aussi déroutante.
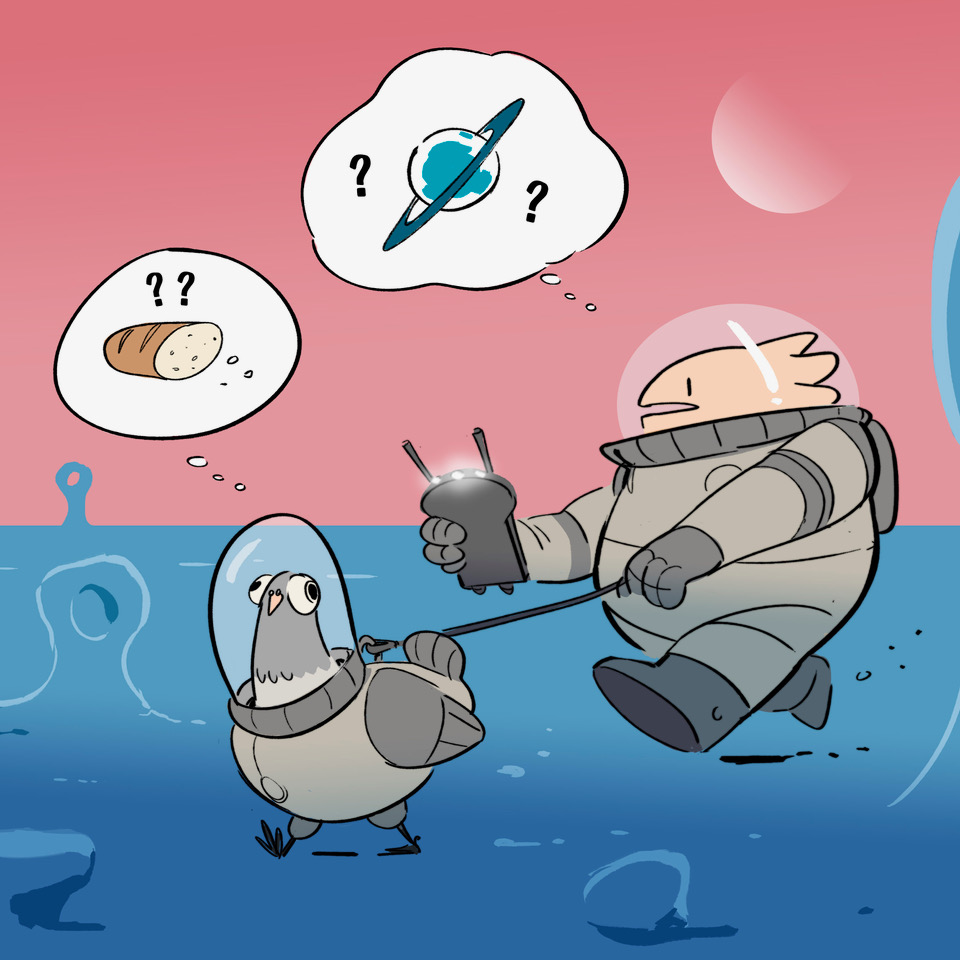
Toutefois certains scientifiques doutent que ces hypothèses suffisent. La magnétoréception est certainement réelle chez certaines espèces, mais posséder une boussole ne suffit pas à retrouver un lieu quand on ne sait pas où l’on se trouve à la surface du globe. Des biologistes ont enregistré les déplacements de pigeons et de tortues de mer en les baguant ou en suivant leur itinéraire au moyen d’une balise GPS ; ils ont testé toutes les hypothèses avancées (mémorisation des trajets, repérage au soleil, aux indices visuels, à l’odorat, au champ magnétique). Elles ont toutes été invalidées. Aucune n’explique comment les poissons migrateurs retrouvent leur rivière, les oiseaux leur île, ou comment les tortues vertes se dirigent, en ligne droite et en compensant pour les courants, entre la côte du Brésil et la petite île de l’Ascension située à deux milles kilomètres (Papi & Luschi 1996).
La navigation biologique ressemble beaucoup à une forme d’intuition scientifiquement démontrée chez l’Homme : c’est une intuition qui permet de localiser quelque chose, quelle que soit la distance, et de savoir, sans raisonnement, sans indice, dans quelle direction il faut aller. Cette intuition nous fait ressentir dans le corps où se trouve l’objectif à atteindre, et si l’on s’en rapproche ou si l’on s’en éloigne. Cette forme d’intuition était sans doute plus développée jadis, dans les sociétés humaines qui n’avaient ni signalisation, ni cartes, ni GPS. Cette aptitude semble remarquable encore aujourd’hui chez des peuples de chasseurs-cueilleurs comme les Bushmen du Kalahari (Van der Post 1962). N’est-ce pas cela qui est à l’œuvre chez le chat perdu dans Yellowstone, l’albatros, la tortue marine, l’esturgeon ou le papillon monarque ?
Quelle intuition étudier, chez quels animaux ?
Depuis l’Antiquité les Hommes ont suspecté les animaux d’avoir une intuition du futur, car ils ont constaté que des catastrophes (incendies, inondations, séisme) étaient annoncées par les comportements inhabituels d’animaux de toutes sortes – rats, oiseaux, poissons, insectes, vers de terre…
Il y a eu peu d’expériences pour tester en laboratoire l’intuition des animaux. Les rares études se sont focalisées sur des mammifères comme des chats, des souris, des lapins ; ou encore sur des oiseaux – perroquets (Sheldrake & Morgana 2003), moineaux du Japon (Alvarez 2010). Mais on pourrait imaginer des expériences où les protocoles utilisés pour mesurer l’intuition humaine sont adaptés à des pieuvres, des dauphins, et toutes sortes d’animaux.
Il semble particulièrement intéressant de rechercher les manifestations de l’intuition chez des créatures considérablement éloignées de l’humain et des mammifères. A quoi ressemble l’intuition, le cas échéant, chez une pieuvre dont le cerveau a 40 lobes et dont trois neurones sur cinq se situent dans ses bras ? Un cerveau est-il nécessaire pour que des formes d’intuition se manifestent ? On peut en douter, car une forme d’intuition a été observée chez des vers planaires.
Les vers planaires (Girardia dorotocephala) sont des vers plats aquatiques très utilisés en biologie car ils possèdent de fascinantes propriétés de régénération de parties entières de leur corps (coupez-en un, vous en obtenez deux !). Un biologiste espagnol les a choisis comme sujets d’une expérience destinée à tester s’ils pressentaient, par une forme d’intuition du futur, des stimuli déplaisants survenant à des moments impossibles à prévoir. Rappelons que ce type d’intuition, surnommé « pressentiment », a été constaté chez les humains. Les stimuli étaient des sons agressifs, et les vers montraient leur réaction anticipée au stimulus à travers la fréquence d’agitation de leur tête. L’analyse des résultats est que les vers planaires semblent bien montrer les signes d’une intuition de ce type (Alvarez 2016).
Montrer que l’intuition existe chez toutes sortes d’espèces est intéressant dans une perspective évolutionniste. Certains ont avancé que l’intuition s’est développée avec la complexité biologique (Broughton 2015). Par ailleurs, ces recherches semblent importantes parce que la biologie connait depuis quelques années une évolution, pour ne pas dire une révolution, caractérisée par un élargissement des concepts de cognition, d’intelligence et même de conscience.
Des résultats récents montrent des comportements intelligents sophistiqués pour des animaux chez qui on ne les attendait pas : poissons, tortues, pieuvres… Sans parler des insectes, dont l’intelligence émerge au niveau de la colonie. On ne peut étudier l’intelligence animale que par ses manifestations objectivables : le comportement. Or le comportement de certaines espèces, à propos desquelles il était difficile, il y a peu, d’employer le vocable « intelligence », intrigue de plus en plus.
Cette nouvelle génération de biologistes révèle les impressionnantes facultés de mémorisation, d’apprentissage, d’anticipation, de décision, qu’ont diverses plantes (Mancuso 2015) ou des organismes à une seule cellule de la famille des myxomycètes, aux faux-airs de lichens ou d’amibes géantes, appelés physarum polycephalum – le « blob » (Dussutour 2017). Blobs et plantes n’ont aucun système nerveux, mais ont des comportements riches et complexes, mémorisent, prennent des décisions optimisées – pour trouver leur nourriture à travers un labyrinthe, notamment (Nakagaki 2000, Adamatzky 2011). Pourraient-ils avoir des formes d’intuition ? Peut-on tester cela expérimentalement ?
Intuition du végétal
Cleve Backster, ancien officier de la CIA, était expert en polygraphes, autrement dit, en détecteurs de mensonge. Le polygraphe est un appareil qui mesure une conductivité électrique de la peau entre deux électrodes, or celle-ci varie à cause de notre transpiration, inconsciente, en fonction de nos pensées et de nos émotions.
Backster eut un jour l’idée de placer les électrodes du polygraphe sur les feuilles de diverses plantes, et de voir si ces plantes réagissaient à des stimuli – positifs, comme un arrosage bienvenu, ou négatifs, comme la brûlure d’un briquet ou la découpe d’une feuille.
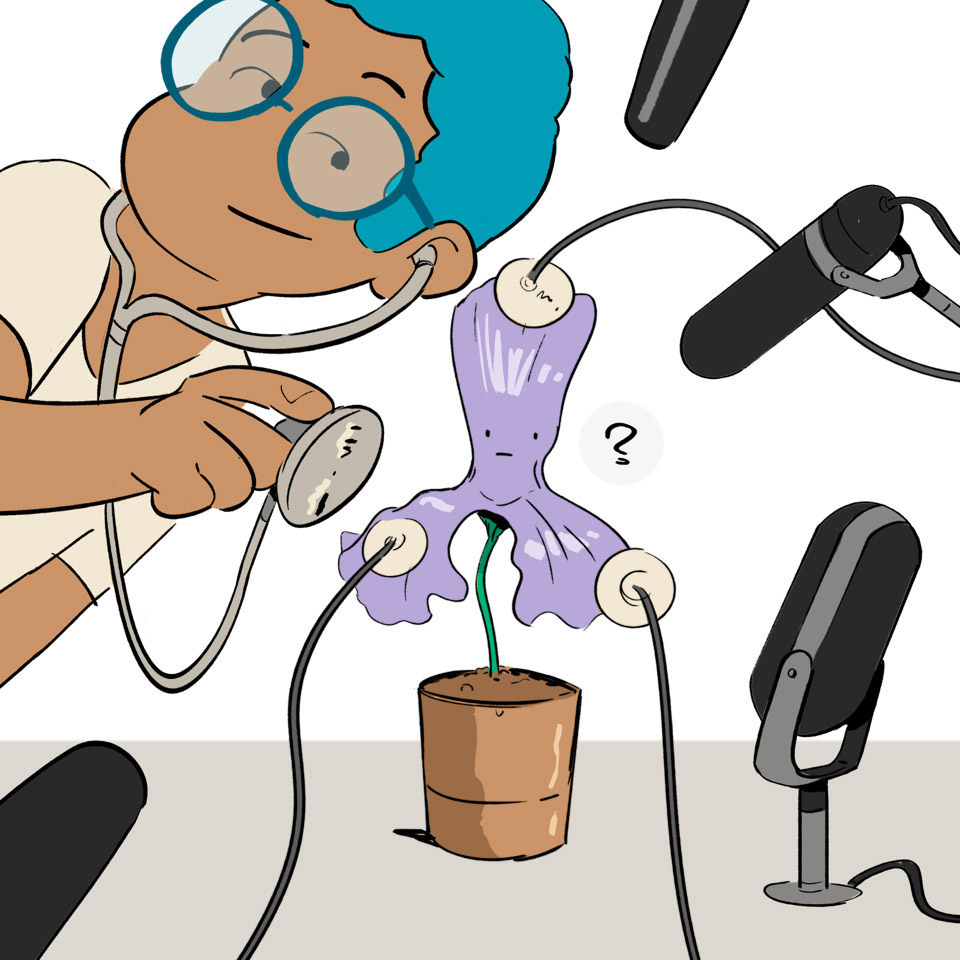
Ces travaux sont controversés, mais c’est surtout parce que personne n’a cherché à les dupliquer. Pourtant ils le mériteraient. Des travaux de botanique récents montrent que les plantes communiquent et perçoivent leur environnement plus finement que ce que l’on croyait et sans que cela passe par des signaux de nature chimique (Baluska et al. 2006, Gagliano et al. 2012). On a avancé d’hypothétiques influences magnétiques ou acoustiques, mais elles ne sont pas démontrées. La piste d’une intuition non locale végétale ne doit pas être exclue, et il serait possible de la tester au moyen d’expériences de botanique innovantes.
Le 25 octobre 2022, profitant d’une éclipse solaire, une équipe internationale de botanistes a étudié l’activité bioélectrique simultanée de plusieurs arbres (des épicéas d’âges variés) dans les Dolomites, en Italie. Pour cela, ils ont placé sur ces arbres des électrodes qui enregistrent les courants électriques induits par leur activité physiologique. Les chercheurs ont découvert que pendant la période d’obscurité due à l’éclipse, la corrélation des signaux provenant des différents arbres s’est accrue, comme si leur activité physiologique se synchronisait (Chioliero et al. 2025).
Ce résultat révèle une forme de communication entre les arbres. Mais le plus surprenant est que pour les arbres les plus vieux, la réponse à l’éclipse a commencé à se produire une dizaine d’heures avant ! Pareille anticipation est inexplicable par un changement dans l’environnement (températures, courants d’air, sons, autre) que pourrait causer l’éclipse. Il faut donc supposer que les vieux arbres possèdent des sens d’une sensibilité extraordinaire doublée d’une mémoire qui les rendent capables de prévoir l’arrivée d’une éclipse des heures à l’avance.
A moins que l’équipe de chercheurs, tout simplement, ait enregistré sans le savoir un superbe cas de pressentiment physiologique végétal !
Intuition et superorganismes
Les entomologistes qui ont étudié les colonies d’insectes sociaux se sont demandé comment, à partir de facultés cognitives réduites, ces animaux dont le système nerveux tient dans une tête d’épingle sont capables, collectivement, de produire des architectures sophistiquées et d’avoir des stratégies de groupe élaborées au point que la colonie évoque un superorganisme doté d’une âme unique (Marais 1973, von Frisch 1974). Les biologistes ont aussi été fascinés par la manière dont certains poissons nagent en bancs, ou dont certains oiseaux volent en nuées, dans des chorégraphies parfaites, donnant l’impression qu’il y a un maestro (qui n’est pas le cas) ou que le groupe est une entité (Selous 1936, Potts 1984).
Ces questions renvoient à la notion d’intelligence cognitive – une intelligence d’ordre supérieur, qui émerge dans un groupe à partir des intelligences réduites des agents qui composent ce groupe (Danilov 2019). Ce sujet est à la mode parce qu’en cybernétique, on étudie aussi comment des robots ou des automates aux performances limitées peuvent, en combinant leurs opérations, contribuer à des performances collectives surpassant de loin la somme des performances individuelles. Qu’il s’agisse des robots et des automates, des termites et des fourmis, ou des oiseaux et des poissons qui forment des essaims, l’intelligence collective émergerait d’une collaboration en réseau des individus, à travers des échanges de signaux classiques. Toutefois l’étude fine du fonctionnement de ces « superorganismes », montre que l’information dans le groupe ne se propage pas entre individus de façon classique : les observations montrent quelque chose qui ressemble beaucoup à de l’intuition, capable d’anticiper les intentions des autres individus et de viser un objectif de façon commune, holistique, indépendamment de la complexité, du temps et de l’espace.
S’il existe une intuition entre animaux, il est logique de la trouver préférentiellement chez des animaux dont le comportement est social, vivant en meutes, en bancs, en colonies, sous forme d’une intuition partagée qui permet au groupe d’être plus efficace, par le transfert instantané d’informations et la coordination des comportements individuels. Comme pour l’intuition entre humains, l’existence d’un lien (affectif ou génétique) semble corrélée à l’observation de cette intuition animale (Sheldrake 1999).
On peut toutefois émettre l’hypothèse qu’une telle intuition non humaine ne s’arrêterait pas là, et qu’elle pourrait aussi s’établir entre individus de différentes espèces, notamment celles qui partagent un même espace, un territoire, un écosystème. Les relations d’interdépendance que tissent les espèces d’un même écosystème sont souvent d’une complexité improbable (Barbault 2006). L’hypothèse d’une forme d’intuition universelle, mise au service de la coopération et de la coévolution entre espèces, offre aux biologistes de nouvelles pistes pour interpréter les lois de l’évolution et comprendre comment des réseaux symbiotiques complexes peuvent émerger.
D’une façon générale, très peu d’études expérimentales de l’intuition non humaine ont été réalisées à ce jour. Le champ d’exploration est immense, et les enjeux ne le sont pas moins puisqu’il s’agit, potentiellement, de bâtir un nouveau paradigme sur ce que sont la conscience et la vie.
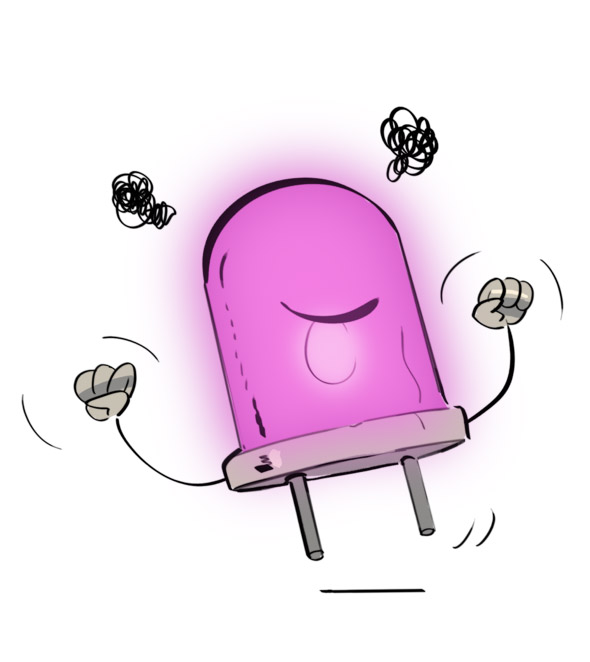
De nombreux comportements animaux font penser à de l’intuition pure (non locale), mais la plupart des biologistes pensent pouvoir les expliquer par l’échange d’indices chimiques, électromagnétiques, acoustiques ou visuels ; dans le cas des bancs de poissons et des nuées d’oiseaux, les formes mouvantes d’une impressionnante cohérence seraient explicables par une communication sensorielle classique entre les individus qui s’influenceraient de proche en proche (McFarland 1981). On ne peut l’exclure a priori, et dans le domaine de l’intuition animale il est parfois difficile de distinguer ce qui relèverait de l’intuition pure d’autres facteurs – perceptions sensorielles, habitudes, intellect (fut-il rudimentaire). Plusieurs travaux ont réussi à modéliser par ordinateur des structures mouvantes collectives qui ressemblent beaucoup aux observations des nuées. En 2024, une équipe de l’université de New York a même montré que les oiseaux volant côte à côte pouvaient s’influencer par leurs battements d’ailes, qui génèrent des « flonons » – des flux d’air se propageant à travers le groupe comme une onde (Newbolt et al. 2024). Toutefois, ce type de modèle laisse des questions sans réponse. En filmant le vol des étourneaux au moyen de caméras ultra-rapides, on s’est aperçu que l’information associée à un changement de forme ou de direction de la nuée se propage d’un oiseau à l’autre en 15 milliseconde, alors que le temps de réaction de chaque oiseau à un stimulus sensoriel est trois fois plus long (Potts 1984). Tout se passe donc comme si chaque oiseau anticipait de plusieurs dizaines de millisecondes ce que feront ses voisins. Chez les humains, cela s’appelle l’intuition du pressentiment.
Nous contacter
iRiS Intuition Lab
📞 09 81 95 07 14
📨 contact@iris-ic.com
86 rue de Charonne, 75011 Paris

