Intuition et nature du temps
L’intuition, qui permet notamment de connaître des faits qui ne se sont pas encore produits, taquine nos idées reçues sur le temps, sa direction, la chronologie des causes et des effets – la causalité. Philosophe et scientifiques cherchent à comprendre, depuis des siècles, ce que sont le temps, la conscience, la matière. Ces mystères sont intimement liés, et l’intuition est au carrefour de ces questions.
L’intuition (non locale) est une aptitude à savoir des choses sur lesquelles nos sens physiques ne peuvent pas nous renseigner et que nous ne pourrions pas déduire de ce que nous savons déjà. La plupart du temps, l’intuition est inconsciente.
Un de ses aspects les plus intrigants, très étudié depuis un siècle par de nombreuses équipes de chercheurs, est l’intuition du futur. L’être humain peut percevoir des faits qui ne se sont pas encore produits. Cette intuition du futur revêt diverses formes.
Peut-on connaître le futur ?
Dans des expériences dites « à choix forcéLes expériences de 'choix forcé' sont des protocoles inspirés des jeux de hasard, qui permettent de tester et quantifier l’intuition d’une personne par l’analyse statistique de ses taux de succès... Cliquez pour aller plus loin. » – des tests où une personne doit deviner des événements déterminés par le hasard – l’analyse statistique montre que l’être humain devine le futur, même quand ce dernier est indéterminé, de manière plus efficace que s’il choisissait « à pile ou face » (Zdrenka & Wilson 2017).
Par ailleurs, l’intuition du futur se manifeste parfois dans des rêves prémonitoires.
Il existe aussi une intuition du futur proche, quand un événement impactant va se produire quelques secondes plus tard. On peut alors la voir se manifester dans notre corps comme un réflexe anticipé, dont la plupart du temps nous n’avons pas conscience (Mossbridge, Tressoldi & Utts 2012).
On peut aussi mettre en évidence cette intuition du futur dans des tests de psychologie expérimentale classiques, en inversant l’ordre de certaines étapes (Bem 2011, Galak et al. 2012). Par exemple, dans une expérience destinée normalement à mesurer le temps de réaction à un stimulus, on mesure ici d’abord le temps de réaction, avant de montrer le stimulus. Quand le stimulus est une image effrayante, ou un mot de signification négative, le temps de réaction qui a été mesuré montre que la personne l’avait pressentie.
Des dizaines d’études et leurs méta-analysesUne méta-analyse est une étude qui recense toutes les études déjà publiées sur un sujet dans une période donnée ; elle compile leurs résultats dans une base de données… Cliquez pour aller plus loin. montrent que tous les hommes et femmes ont, à des degrés divers, volontairement ou de façon spontanée, des perceptions concernant des événements qui surviendront ultérieurement mais que rien ne permet d’anticiper (Mossbridge & Radin 2018, Mossbridge 2023). Certains chercheurs suggèrent même que l’intuition du futur est la seule réelle faculté intuitive humaine, que toutes les autres formes d’intuition non locale peuvent s’expliquer par notre aptitude – plus ou moins développée ou exploitée – à connaître l’avenir (Marwaha & May 2016).
Ces résultats sont passionnants parce qu’ils semblent contredire le principe de causalité – une règle à laquelle les physiciens et les scientifiques en général tiennent beaucoup, qui s’applique à presque tout ce qu’ils étudient. Depuis que Leibniz a énoncé le principe de raison suffisante, on peut le résumer ainsi : toute chose est cause d’une autre chose, et cette relation de cause à effet est orientée du passé vers le futur. Arthur Eddington, le grand astronome britannique, a appelé cette orientation privilégiée de la causalité la « flèche du temps ».
La flèche du temps
L’image d’un temps qui s’écoule inexorablement, telle une rivière, est ancrée dans nos esprits. Elle prend sa source dans le passé et court vers le futur. Cette vision du temps découle de notre expérience du temps : le futur, nous ne le connaissons pas ; le passé, nous nous en souvenons. Le futur, nous pouvons en décider ; le passé, nous ne pouvons plus le changer. Mais cette vision du temps est aussi culturelle – d’autres cultures conçoivent le temps comme non linéaire et cyclique – et inspirée par la façon dont les savants ont fini par le modéliser.
En effet, les scientifiques constatent une flèche du temps dans tous les domaines : en physique, en astronomie, en géologie, en biologie, même en psychologie, les événements suivent les lois de la causalité, les causes précèdent les effets, la glace fond en se réchauffant, le nuage de lait versé dans le café se dilue, l’aspect de la Terre aujourd’hui n’est pas celui d’il y a cent millions d’années. Le « principe de Carnot » (aussi appelé seconde principe de la thermodynamique), un des piliers de la physique, transpose à l’échelle de l’univers entier le constat du vieillissement. Laissé à lui-même, tout système initialement ordonné, structuré, deviendra désordonné et informe : une ruine ne contenant plus aucune information. Le principe de Carnot se voit dans notre quotidien, au niveau de la vie des étoiles, du cosmos. Le passé de l’univers et le futur de l’univers ne se ressemblent pas. Tout semble chronologiquement orienté.

En ce cas, d’où vient la flèche du temps que nous observons ? C’est un mystère. On tente de l’expliquer en faisant appel au concept de « brisure de symétrie » : de même que la symétrie parfaite ne peut être qu’un idéal pour l’architecte ou le peintre, les systèmes physiques s’écartent très vite, spontanément, de la symétrie théorique qui devrait régir leurs propriétés. Ainsi, les physiciens des particules ont constaté expérimentalement d’infimes déséquilibres entre des taux de désintégration qui devraient être identiques (Christenson et al. 1964); ces minuscules écarts à la symétrie parfaite expliqueraient, par effet boule de neige, des asymétries flagrantes à l’échelle du cosmos : l’écrasant ratio de matière comparée à l’antimatière, ou… la flèche du temps.
Mais il y a d’autres pistes théoriques pour comprendre la flèche du temps : elle pourrait découler du fait que la matière peut connaître deux modes d’existence, l’un quantique et l’autre classique. Par un phénomène appelé « décohérence », toute matière quitte tôt ou tard le premier pour le second. C’est cette transition – irréversible – entre le monde quantique et le monde classique qui induirait l’orientation du temps, du passé vers l’avenir, pour tous les phénomènes que nous observons (Zeh 2007). (cf Symétrie du temps et hasardLa symétrie (ou asymétrie) du temps, et la réalité (ou non réalité) du hasard, sont deux questions essentielles que se posent les physiciens ; elles sont étroitement liées... Cliquez pour aller plus loin.)
Le temps physique : un mystère qui résiste
Pour certains physiciens théoriciens, le temps n’est pas un flux. Il ne s’écoule pas, il n’existe pas en tant que force en mouvement, seulement en tant que dimension (comme une longueur). Le présent n’a pas de réalité. Ce que nous appelons flèche du temps, cette orientation apparente du cours des choses, résulterait seulement d’une asymétrie temporelle du cosmos, parce que son passé et son futur sont très différents (Penrose 1997, Rovelli 2023). Carlo Rovelli pense ainsi que la flèche du temps n’est qu’une illusion d’optique, et que c’est à cause de cela que nous nous souvenons du passé et pas du futur, et que nous décidons du futur et pas du passé.
D’autres théoriciens à l’inverse, pensent que le flux du temps est quelque chose de réel, et que l’instant présent correspond à une réalité fondamentale mal comprise (Smolin 2013). Les physiciens quantiques tendent à voir le temps ainsi, parce que les systèmes quantiques ne cessent de basculer, à chaque instant, d’un état de réalités potentielles, vers un état de réalités actées et irréversibles. Les premiers voient l’espace-temps comme une trame unique, l’histoire entière de l’univers existant en « bloc » et ne pouvant être changée ; les seconds considèrent que le futur est ouvert, l’univers lui-même ignore son destin, improviserait en tout lieu et à chaque instant son histoire, et ses passagers sont libres. Le libre arbitre, impossible du temps de Spinoza et Schopenhauer, est ici possible ; c’est la version humaine du « libre arbitre » quantique des particules et des atomes (Omnès 2006, Gisin 2012). Cette seconde vision du temps est plus proche de philosophes comme Bergson ou Charles Anders-Peirce ; elle attribue à l’univers un mouvement, une évolution ; le hasard y devient un générateur de possibles et la causalité, cessant d’être mécanique, adopte des caractéristiques organiques.
Le temps, cette « grandeur physique » (Costa de Beauregard 1985), au cœur des principales problématiques de la science, passionne les physiciens. A chaque révolution scientifique (newtonienne, quantique, relativité restreinte et générale), le temps se voit attribuer de nouvelles propriétés et coller de nouveaux avatars. Mais sa nature est aussi mystérieuse de nos jours que du temps des Anciens.
En tant qu’êtres humains, nous faisons une expérience directe du temps. Nous le sentons qui s’écoule. Avons-nous un sens du temps comme nous avons la vue et d’autres sens ? Ou s’agit-il d’une construction de notre esprit ?
Le temps des atomes et le temps de la conscience sont-ils de même nature ?
Les humains aussi, connaissent, dans leur vie de tous les jours, dans leur esprit et dans leur chair, la flèche du temps : hier n’est pas demain. Personne ne fait l’expérience de Benjamin Button.
Chacune de nos pensées suit la flèche du temps. Le temps est une variable implicite de tous nos processus cognitifs : nos idées qui s’enchaînent, nos perceptions sensorielles qui entrainent des réactions, nos hésitations qui débouchent sur des décisions – tout cela suit le flux temporel passé-futur. Le philosophe anglais David Hume fut un des premiers à noter que les ingrédients de notre vie psychique sont aussi soumis à des lois de cause à effet.
Pour autant, le temps de la conscience et le temps de la matière sont-ils identifiables l’un à l’autre ? Rien n’est moins sûr.
Pour commencer, le temps que chacun et chacune perçoit en son for intérieur est avant tout l’instant présent : c’est de là que nous faisons l’expérience du monde, que nous percevons, pensons, voulons. C’est depuis ce « vantage point » que nous appréhendons le futur (par l’anticipation et l’imagination) et que nous contemplons le passé (par le souvenir), par des voyages temporels en pensée. Nous habitons le présent, pourtant aucune théorie n’explique ce qu’il est.

Nos concepts de temporalité souffrent peut-être d’une pauvreté de notre vocabulaire. Les Grecs avaient plusieurs mots pour parler du temps, notamment afin de distinguer le temps qui se mesure (Chronos) du temps qui se vit (Kairos). Le philosophe Henri Bergson, qui voulait comprendre comment notre perception du temps se relie au concept de temps des physiciens, était conscient de la difficulté ; il utilisait, pour parler du temps de la conscience, le terme « durée pure » (Bergson 1889).
Mais, s’ils sont de natures différentes, temps de la conscience et temps de la matière sont en lien étroit. Synchronisés, ils dansent un tango serré. Quelle qu’en soit la raison, ils sont engrenés (Costa de Beauregard 1985).
Et c’est ici qu’entrent en scène les recherches sur l’intuition et d’autres facultés non locales de l’esprit humain, car elles impliquent l’articulation entre temps de la conscience et temps de la matière.
Qu’est-ce que le présent ? La physique n’en dit rien ; c’est donc avant tout une réalité psychologique, une donnée immédiate de la conscience. Pour Newton le présent était le nom donné à la séparation entre futur et passé, une frontière infiniment fine. William James, père de la psychologie moderne, a découvert que le « présent spécieux », notre perception du présent, possède une étendue – une fraction de seconde. Dans des expériences plus récentes on a mesuré qu’il s’étend en moyenne de 125 millièmes de seconde dans le passé, et de 45 millisecondes dans le futur.
Dans certains états de conscience modifiés, notamment sous l’effet de substances psychotropes, la durée de l’instant présent semble se dilater au point d’englober la totalité du temps. Encore un indice, s’il en fallait, que physiciens et psychologues se méprennent lorsqu’ils croient, parlant du « temps », étudier la même chose.
Temps et psychophysique
D’un côté, il y a le temps de la conscience – notre perception du temps présent, des durées, du flux temporel s’écoulant du passé vers le futur, et toutes les conséquences de cela (mémoire, volonté, prise de décision, apprentissage…) ; de l’autre, il y a le temps de la matière, mesurable avec des horloges, au cœur des processus de l’univers et de son évolution. Ce sont deux réalités, deux concepts ; la manière dont ils sont liés reproduit les difficultés et les enjeux qu’on rencontre quand on aborde la question du lien entre la conscience et la matière, ce que les philosophes appellent le problème esprit-matièreDepuis des siècles, l’homme s’interroge sur la nature de la conscience et ses liens avec la réalité physique. Les philosophes s’y réfèrent avec un terme générique... Cliquez pour aller plus loin..
Les recherches sur l’intuition, parce qu’elles se situent à l’interface entre l’esprit et la matière, peuvent apporter leur éclairage sur ces questions.
Les scientifiques qui étudient l’intuition dans ses diverses modalités (intuition temps réel, intuition du futur, pressentiment et corrélations physiologiques) et les effets physiques de l’intention (nature de l’intuition), se sont toujours beaucoup intéressés à la nature complexe et mystérieuse du temps (Bem et al. 2011, Mossbridge & Radin 2018, Mossbridge 2023) ; parce que la non-localité de ces phénomènes questionne ce que les physiciens disent sur le temps (en particulier, la causalité), et aussi pour ces raisons plus profondes encore – parce que temps et conscience semblent intimement liés.
ZOOM : COMMENT LE CERVEAU GERE-T-IL LA PERCEPTION DU TEMPS ?
La perception subjective du temps implique l’activité simultanée de nombreuses régions du cerveau, traitant différents aspects du temps – par exemple la différence entre « quand » et « combien de temps ». Les biologistes et les neurologues ont fait d’intéressantes découvertes sur la manière dont le corps utilise toutes sortes processus cycliques dans la matière, au niveau des gènes ou au niveau des cellules, pour disposer d’horloges. Il existe plusieurs types d’horloges dans le cerveau, caractérisées par plusieurs échelles de temps. Par exemple, des horloges moléculaires sont utilisées pour les rythmes circadiens ; la dynamique des neurones est utile pour les durées de l’ordre de la minute ou de l’heure ; les constantes de temps neuronales adaptées aux durées de 100 msec à 1 sec. Ce sont par exemple les délais temporels des axones.
Il y a deux évaluations du temps, l’une pour l’action et l’autre pour les perceptions – le motor timing et le sensory timing. La première nécessite un apprentissage – comme lorsqu’un musicien débutant développe son sens du rythme. La chercheuse Jennifer Coull et ses collègues ont montré que la région SMA (aire motrice supplémentaire) du cortex, impliquée dans la préparation des actes moteurs (nos mouvements), est aussi impliquée dans notre perception du temps (Coull 2015). Une méta-analyse d’une centaine d’études utilisant l’IRMf le montre (Nani et al. 2019). La raison est peut-être dans l’apprentissage du lien étroit entre perception du temps et décision d’agir.
Symétrie du temps et intuition
L’intuition du futur, démontrée par les expériences, n’est pas compatible avec une vision du monde où la causalité et la flèche du temps règnent en principes absolus. En revanche, la symétrie du temps envisagée par la physique moderne pourrait autoriser, en principe, que des informations remontent le temps depuis le futur, et donc que l’esprit humain puisse, depuis le présent, connaître des choses sur des événements qui ne se sont pas encore produits. La théorie quantique par exemple, autorise des formes de non-localité spatiale et temporelle, et des relations de cause à effet orientées du futur vers le passé, qui se manifestent dans certaines expériences de physique avec des lasers (Pfleegor & Mandel 1967, Ma et al. 2016).
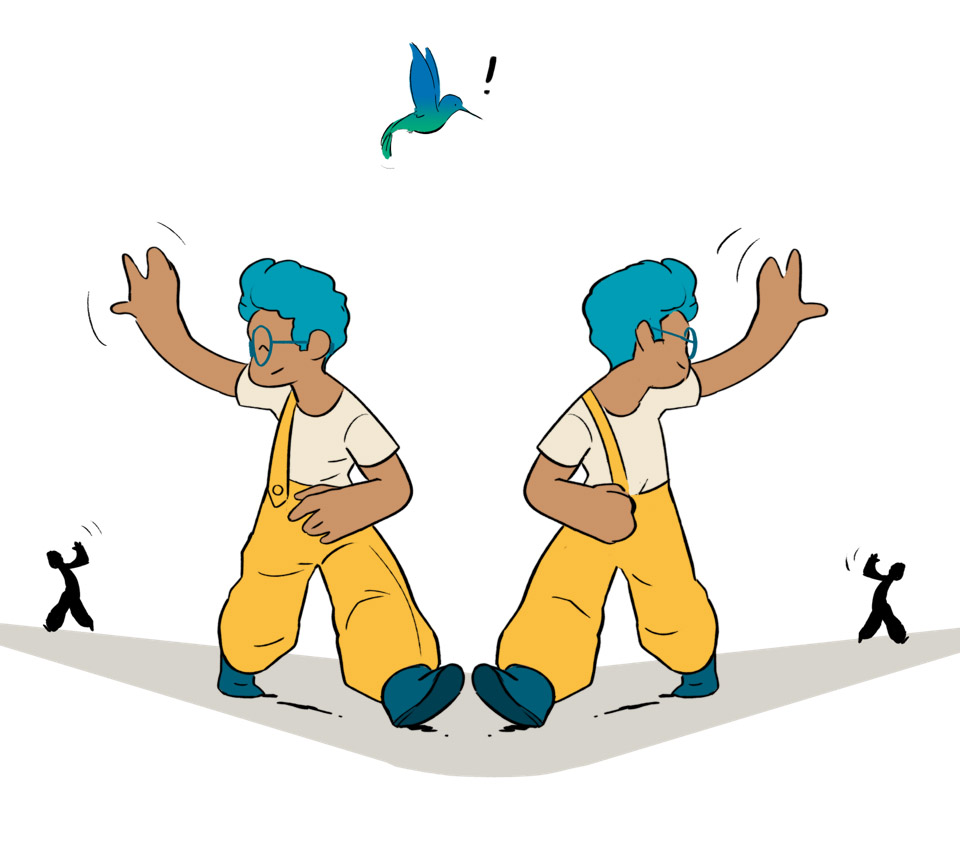
Ces théories sont insuffisantes, toutefois. Des questions essentielles restent sans réponse (par exemple, le futur est-il écrit ou indéterminé ?), et il est probable que la physique ne les résoudra pas tant qu’elle n’abordera pas tous les aspects du réel, y compris la réalité subjective, la conscience. La question du temps est au cœur de ce débat. Nier toute réalité à la perception subjective du temps, ou l’identifier aux processus temporels dans la matière, c’est nier implicitement la réalité de la conscience – un biais matérialiste, qui n’est qu’une croyance.
De toute évidence la nature de la conscience et la nature du temps sont deux mystères qui s’entremêlent. C’est pourquoi les philosophes qui ont le plus réfléchi aux relations entre le corps et l’esprit, sont aussi ceux qui ont cherché comment concilier l’expérience du libre arbitre avec les lois de causalité.
Sur ces questions importantes, les recherches sur l’intuition et les effets physiques de l’intention peuvent apporter leur lumière. L’intuition du futur donne à percevoir des faits : sont-ils écrits et inévitables (vision relativiste) ? ou sont-ils seulement possibles, et plus ou moins probables (vision quantique) ? L’intention, lorsqu’elle est conscientisée, met en scène notre libre arbitre : est-il réel ou illusoire ? On voit combien ces recherches sur l’intuition et l’intention, les deux aspects dits « psychophysiques » de l’interaction entre l’esprit et la réalité, sont des façons pertinentes de tester différentes hypothèses sur les lois de la conscience et de la matière.
Par exemple, il a été proposé (Tressoldi et al. 2015b) d’analyser les données expérimentales sur l’intuition du futur pour y chercher la signature d’une intrication à travers le temps postulée par les physiciens (Leggett & Garg 1985, Kofler & Brukner 2013) ; ou encore pour tenter déterminer si le futur perçu par l’intuition est de nature irrévocable ou plutôt probabiliste (Radin 1988, Tressoldi 2015a).
Comment peut-on accepter l’existence du hasard (essentiel en théorie quantique) et la réalité du libre arbitre (si l’on y croit), avec le fait que le futur serait déjà écrit ? Ou, ce qui revient au même, la possibilité de connaître ce futur à l’avance ? S’il est possible de connaître le futur, c’est qu’il est déjà écrit, et alors, le hasard n’est pas du vrai hasard et ce que nous prenons pour de la liberté n’en est pas non plus. La question se posait du temps d’Aristote et au Moyen-Age, parce qu’on voulait croire à la liberté de l’esprit humain autant qu’à sa prédestination et à l’omniscience divine. Elle s’est posée durant trois siècles de science classique, avec le postulat que les lois naturelles sont déterministes (rendant notre libre arbitre impossible ou incongru). La question se repose aujourd’hui avec la relativité générale, qui autorise en théorie le voyage temporel, ce qui conduit à des paradoxes.
L’intuition du futur nous confronte à des paradoxes temporels similaires : si une personne a la prémonition ou le pressentiment d’un événement qui ne s’est pas encore produit – par exemple une rencontre déterminante qui transformera sa vie – que perçoit-elle, un fait inévitable ou un événement qui, selon ce que la personne décide de faire, pourrait ne pas se produire ? Dans un monde déterministe, où le futur est écrit, et nos vies prédestinées, le futur dont on a l’intuition est inéluctable. Mais si le monde est indéterministe, rien n’est joué et rien n’est acquis. Mais alors, qu’est ce futur virtuel qu’avait perçu l’intuition ?
Quelques expériences sur l’intuition abordent frontalement ces questions (Tressoldi 2015a, Radin 1988). Elles nous semblent peu nombreuses au regard de leur importance.
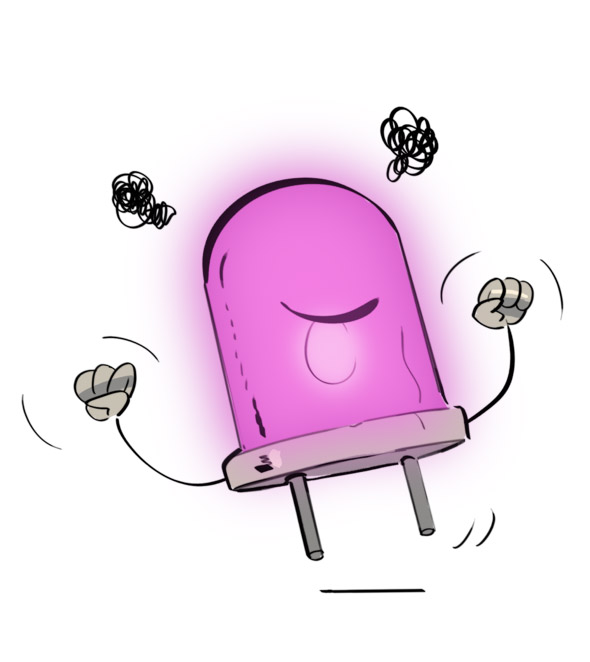
Au cœur du débat sur la nature du temps, il y a la question du libre arbitre. Les neurobiologistes, très majoritairement, n’y croient pas (Singer 2013, Charpier 2025). Selon eux, les derniers clous dans le cercueil de cette notion sont les expériences de « style Libet », qui montrent que l’activité cérébrale associée à une décision libre est antérieure à cette décision elle-même (Libet et al. 1982, Haggart & Eimer 1999) ; l’être humain serait donc commandé par son cerveau, et dupé par lui lorsqu’il croit être libre de ses choix. Cette conclusion semble juste… tant que l’on est convaincu que l’esprit est un épiphénomène de la matière, soumis à la même temporalité. Cependant, des faits empiriques – l’intuition non locale, les effets physiques de l’intention – invitent à changer notre point de vue sur la relation entre la conscience et le cerveau. Les expériences de Libet peuvent, précisément, être interprétées comme un indice (un de plus) que la conscience n’est pas prisonnière de l’espace-temps !
Nous contacter
iRiS Intuition Lab
📞 09 81 95 07 14
📨 contact@iris-ic.com
86 rue de Charonne, 75011 Paris

